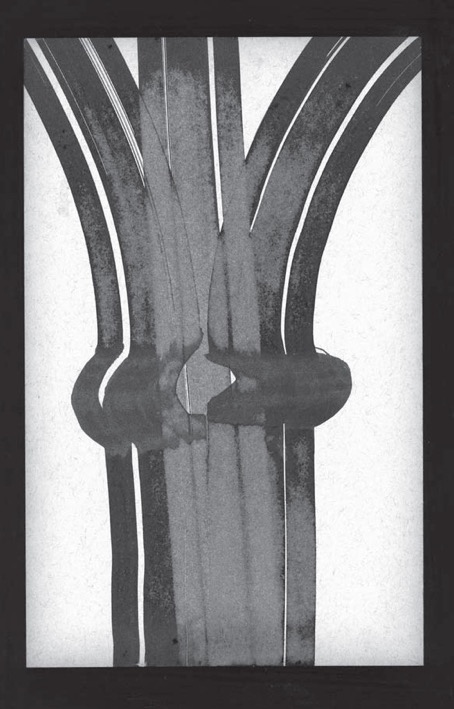Après la mort de Pierre Boutang, et surtout peu après le début de la « deuxième intifada », j’ai contacté Michaël Bar-Zvi à Tel Aviv pour l’inviter à prendre part à notre effort de redressement des mentalités (comme disait Ionesco) ; il m’a aussitôt répondu ceci : « Malgré les difficultés que vous pouvez imaginer, je suis décidé à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour convaincre que Pierre Boutang et sa pensée permettent de fonder une nouvelle alliance entre juifs et chrétiens. J’ai lu avec attention votre revue et je crois que vous avez compris cet aspect de sa philosophie et de son engagement. Ceux qui l’ont connu de près, comme moi, savent que c’est essentiel. Ma relation avec lui pendant plus de trente ans me permet sans aucun doute de parler de lui avec une tendresse et une fidélité presque filiales. » (Boutang avait été son professeur de philosophie au lycée Turgot en 67-68.)
Après quoi il rédigea de nombreux textes de circonstances pour Les provinciales et nous avons réédité son livre sur Le Sionisme (2002) et publié sa thèse, Être et Exil, philosophie de la nation juive (2006) qui n’enfoncent pas exactement des portes ouvertes : « Le nationalisme se fonde sur l’idée que ce qui nous semble premier et légitime possède une puissance telle que nous devons le préférer à toute autre réalité. Ainsi le père est non seulement aimé comme tel mais il devient mon préféré dans l’ordre du monde. Vouloir garder cette préférence c’est être nationaliste. »
Puis ce fut Éloge de la guerre après la Shoah (pourquoi la guerre a commencé le 8 mai 1945, chez Hermann, 2010), Israël et la France, l’alliance égarée (2014), Pour une politique de la transmission, réflexions sur la question sioniste (2016), et nous préparions la mise à jour de sa très nécessaire Philosophie de l’antisémitisme. Mais il y a eu aussi ses importantes postfaces à la réédition des textes de Boutang sur La Guerre de six jours (2011) et La Politique, la politique considérée comme souci (2014), « ce livre lu au début de l’année 68, qui m’a servi de bouclier absolu contre les fascismes de droite comme de gauche, une sorte de vaccin contre toute tendance à accepter une forme quelconque d’idéologie totalitaire » – ainsi que tous les livres dont il a soutenu la publication pour donner un contexte à l’héritage gréco-hébraïque de Pierre Boutang : ceux de Jabotinsky, Ghislain Chaufour, Richard L. Rubenstein, Henri Du Buit, Pierre-André Taguieff, Fabrice Hadjadj, Yoav Gelber, Richard Millet, Sébastien Lapaque et surtout Bat Ye’or.
Michaël Bar-Zvi nous a ainsi donné, en France, une œuvre essentielle, qui complète son action en Israël : sa philosophie de la royauté et de l’appartenance à un peuple auquel donner tout « ce qu’il nous reste d’être », la transmission et la guerre étant l’expression des plus hautes vertus humaines face à la violence barbare. Né à Paris en 1950, il se trouve que c’est à Paris qu’il a livré avec noblesse et parfaite maîtrise de soi sa dernière bataille contre la mort il y a huit jours, puis il a été rapatrié et enterré à Tel Aviv dans la terre rouge et la lumière rasante du soir, chef de file héroïque enveloppé dans son châle de prière d’un vrai peuple qu’il a contribué à armer contre l’adversité, la stupidité des hommes, l’oubli et leur manque de cœur.
Un de ses derniers textes, sa belle contribution au Dictionnaire des conservatismes, anéanti l’illusion rétrograde de ceux qui prétendent ignorer ou réduire Israël à une affaire lointaine. « L’homme européen ne se trouve pas éminemment en Europe, ou n’y est pas éveillé, écrivait Boutang dès 1967. Il est, paradoxe et scandale, en Israël ; c’est en Israël que l’Europe profonde sera battue, “tournée”, ou gardera, avec son honneur, le droit à durer ». Michaël Bar-Zvi aura mis toute sa vie pour lui répondre précisément ceci : « Je crois que la pierre de touche de la nouvelle alliance est la délivrance d’un secret passage de l’exil à l’être, c’est en cela que le paradigme du peuple juif est à la fois national, lié à une terre, non comme une possession mais comme une demeure de l’être (ça sonne un peu heideggerien, tant pis) et ontologique, parce que sans le désir métaphysique défini par Levinas comme une sortie de soi, comme une aventure vers l’absolument autre, il ne saurait y avoir de morale politique… »
Olivier Véron