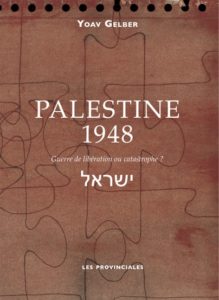 Il y a douze ans, en pleine deuxième Intifada, une controverse surgit dans ma classe à l’université de Haïfa. Les étudiants discutaient des droits antinomiques sur la Palestine et je fus atterré par leur ignorance du contexte historique. J’intervins et demandai à trois étudiants de se rendre dans le hall d’entrée en empruntant chacun des directions différentes et de poser la question suivante aux cinq premières personnes qu’ils rencontreraient : à qui étaient les « territoires » qu’Israël (j’avais dis « nous ») avait occupés en 1967 ? Le trio sortit et revint faire son rapport quelques instants plus tard : sur quinze réponses, douze affirmaient : aux Palestiniens ! J’en tirai la conclusion que l’ignorance ne se limitait pas à ma classe.
Il y a douze ans, en pleine deuxième Intifada, une controverse surgit dans ma classe à l’université de Haïfa. Les étudiants discutaient des droits antinomiques sur la Palestine et je fus atterré par leur ignorance du contexte historique. J’intervins et demandai à trois étudiants de se rendre dans le hall d’entrée en empruntant chacun des directions différentes et de poser la question suivante aux cinq premières personnes qu’ils rencontreraient : à qui étaient les « territoires » qu’Israël (j’avais dis « nous ») avait occupés en 1967 ? Le trio sortit et revint faire son rapport quelques instants plus tard : sur quinze réponses, douze affirmaient : aux Palestiniens ! J’en tirai la conclusion que l’ignorance ne se limitait pas à ma classe.
Deux semaines plus tard, une journaliste néerlandaise m’interviewa sur le conflit israélo-arabe. Au cours de l’entretien, je lui racontai cette anecdote comme un exemple du caractère extrêmement lacunaire des connaissances sur ce conflit. Stupéfaite, elle ouvrit de grands yeux et demanda : « Et ce n’est pas vrai ? Aux Pays-Bas, tout le monde pense cela… »
L’ignorance est le terrain fertile sur lequel se déchaîne la haine d’Israël. Dans des pans entiers de l’opinion publique, ce phénomène a cessé d’être un vice ou une carence pour se présenter presque comme une vertu. La connaissance est devenue superfétatoire ; ce qui importe désormais c’est la conformité à l’air du temps.
L’histoire est ainsi remplacée par des mythes. Les mythes sont les fondements des narratifs et il ne faut pas confondre histoire et narration. Les narratifs ne transmettent ni ne produisent de savoir ; ils ne constituent pas non plus une information fiable sur le passé ; se nourrissant de l’erreur et de l’ignorance, ils exagèrent et camouflent, inventent et oublient. Rien ne sert de les accuser de parti pris, puisque le parti pris est leur essence même. L’histoire aspire à réduire les préjugés, les narratifs les consacrent. Ils idéalisent le passé ou le diabolisent, mais la tâche des historiens consiste à présenter un tableau équilibré qui repose sur des preuves.
Avec le temps, les narratifs israélien et palestinien se sont écartés l’un de l’autre et n’ont jamais été aussi éloignés qu’à présent. La divergence est flagrante dans les travaux de recherche, la brèche s’élargit lorsqu’on lit des études se fondant sur les souvenirs, le fossé se creuse lorsqu’on écoute les arguments populaires extrêmement répandus : ainsi, de nombreux Israéliens nient l’existence d’une nation palestinienne et soutiennent que les Arabes, disposant de vingt-deux États, n’en ont pas besoin d’un autre, ou que la Jordanie est en fait l’État palestinien. Pour leur part, les Palestiniens affirment être les descendants des habitants de Canaan, avant l’arrivée des Hébreux, ou les descendants de Juifs convertis à l’islam après la conquête du pays par les Arabes…
De nombreux observateurs considèrent l’État juif comme la conséquence directe de la Shoah, en quelque sorte son épilogue, ou comme la compensation accordée par le monde aux Juifs pour les souffrances endurées, et les sympathisants de la cause palestinienne voudraient que le monde dédommage enfin les Palestiniens pour l’erreur commise en novembre 1947. Ilan Pappe, principal porte-parole de cette théorie, affirme que les sionistes ont utilisé la Shoah comme une arme morale en vue d’obtenir le soutien américain pour prendre le contrôle de la Palestine et expulser ses habitants arabes.
Cependant l’État juif était déjà à l’ordre du jour avant la guerre, tirant sa légitimité non pas de la Shoah mais de l’histoire juive. Sa viabilité fut confirmée par la victoire de la guerre de 1948, par l’intégration en Israël de plusieurs vagues d’immigration, et par la consolidation de l’État juif lors de la victoire de 1967 et ensuite.
La Shoah n’a pas provoqué la création d’Israël, elle a failli mettre fin aux perspectives d’un État juif dont la guerre en Europe avait anéanti les réserves démographiques .
Les historiens qui traitent de la plupart des guerres et des conflits parviennent plus ou moins à se détacher de l’objet de leurs travaux. Le conflit israélo-arabe échappe à cette règle. L’affrontement se poursuit et ne semble guère près de prendre fin. Aucun des problèmes qui furent laissés en souffrance à la fin de la guerre d’Indépendance d’Israël en 1949 ou qui surgirent plus tard n’a été résolu. Chaque mot écrit ou prononcé sur ce conflit est porteur d’implications. Ce sujet est souvent abordé et interprété, non pas dans son contexte historique, mais en tant que combat qui perdure aujourd’hui et entend façonner l’avenir. La persistance du conflit attire l’attention sur ses aspects actuels aux dépens de ses racines historiques, lesquelles ont, semble-t-il, perdu de leur pertinence. L’ignorance règne en maître, la mémoire semble défaillante, l’opinion publique et les hommes politiques font preuve d’impatience ; dans ces conditions, la propagande parvient sans peine à rivaliser avec l’histoire. La propagande, les mémoires, les romans et les écrits de circonstances, ainsi que l’historiographie des débuts ont entouré cette guerre d’un épais voile de stéréotypes, mythes, polémiques et justifications. Dans les années 1950 et 1960, l’historiographie israélienne et les ouvrages de fictions considéraient la guerre comme un miracle. Elle était présentée comme le triomphe de quelques uns sur le nombre, du faible sur le fort, du juste sur l’injuste. Les auteurs accusaient la Grande-Bretagne d’avoir orchestré en secret l’agression palestinienne contre le Yishouv ainsi que l’invasion d’Israël par les armées arabes, d’avoir tenté d’étouffer dans l’œuf l’État juif. Le progrès des recherches sur la guerre modifièrent cette approche naïve. Au cours des années 1970, l’attitude des universitaires occidentaux à l’égard d’Israël se fit plus critique. En Israël, dans les années 1980, Tom Segev mit en cause l’interprétation commune de 1948 puis Benny Morris, Avi Shlaim et Ilan Pappe mirent l’accent sur les épreuves des Palestiniens. En décrivant les Palestiniens comme d’innocentes victimes, les « nouveaux historiens » ont accrédité la thèse palestinienne accusant Israël d’être né dans le péché. Toute personne connaissant les sources jugera cette approche simpliste peu vraisemblable. Les Palestiniens sont certes des victimes – depuis 1948 – mais ils sont loin d’être innocents. Ils sont les victimes de leur propre agressivité, de leur intransigeance et de leur manque de réalisme. Les post-sionistes, en Israël et à l’étranger, comme Pappe, Oren Yitachel ou Yehouda Shenhav, décrivent le conflit comme un affrontement entre le bien et le mal. À leurs yeux, être une victime équivaut à avoir raison, indépendamment des raisons qui ont fait de lui une victime, tandis que le vainqueur a tort. Se présentant comme un mouvement de libération nationale et une révolution sociale, le sionisme, qui l’a emporté, ne serait donc rien d’autre qu’un colonialisme de la pire espèce, et Israël un avant-poste impérialiste au Moyen-Orient, une société capitaliste malade.
En fait la guerre d’Indépendance d’Israël consista en deux campagnes consécutives, mais distinctes, menées par des ennemis différents, dans des circonstances différentes, chacune des phases sous des régimes différents. Le premier affrontement commença dès le mois de décembre 1947 et dura jusqu’à la fin du mandat britannique en Palestine. Il s’agissait d’une guerre entre civils juifs et civils palestiniens, qui se déroula sous souveraineté britannique, et en présence des troupes britanniques. Le second affrontement commença avec l’invasion de la Palestine par les armées arabes régulières le 15 mai 1948, et se poursuivit jusqu’à la conclusion d’accords d’armistice séparés entre Israël et chaque État arabe (à l’exception de l’Irak) au cours de la première moitié de 1949. Ce fut une guerre entre Israël et une coalition d’États arabes, menée par des armées régulières. En conséquence, les Palestiniens – qui confièrent leur sort aux États et armées arabes – disparurent pour plusieurs décennies de la scène militaire et politique du conflit israélo-arabe. Jusqu’à ce que l’évacuation des troupes britanniques entre dans sa phase principale début avril 1948, aucun territoire ne put être conquis par l’une ou l’autre des parties, ne serait-ce que temporairement. Dénués d’objectifs proprement militaires, les antagonistes lançaient leurs attaques contre des cibles non combattantes, soumettant les civils aux privations, à l’intimidation et au harcèlement. En conséquence, plus faible, moins soudée, désorganisée, la société palestinienne s’effondra sous une pression pas particulièrement forte. Un afflux croissant de réfugiés au cœur des régions peuplées d’Arabes et dans les pays voisins souligna la défaite. Au cours de cette période, la principale organisation paramilitaire juive – la Haganah – devint une armée régulière fondée sur la conscription. Dans le même temps, les institutions nationales juives autonomes évoluèrent en un système de gouvernement indépendant et souverain qui centralisa, contrôla et dirigea l’effort de guerre du Yishouv. La société palestinienne avait du retard. N’ayant pas conscience de la différence entre une insurrection anticoloniale et une guerre nationale, les dirigeants palestiniens préféraient mener la lutte à l’abri depuis l’étranger, comme ils l’avaient fait lors de leur rébellion contre les Britanniques en 1936-1939. Ils négligèrent de créer des structures centrales politiques, financières, administratives et militaires pour mener une guerre. Cette négligence conduisit à une rapide détérioration des institutions locales et à une totale anarchie. La Ligue arabe contribua au chaos en se montrant incapable de déterminer l’avenir politique de la Palestine arabe ou de laisser les Palestiniens prendre en main leur destin. Le retrait britannique permit aux adversaires de changer de tactique. Début avril, la Haganah prit l’initiative des opérations et, au cours des six semaines suivantes, lança plusieurs grandes offensives à travers le pays. Les forces arabes, elles, demeurèrent dispersées dans une confusion totale, s’attachant à leurs modes traditionnels de combat et à leur organisation brouillonne, devenus anachroniques dans les conditions de l’époque. Entre le début avril et la mi-mai 1948, la toute nouvelle armée juive écrasa les milices palestiniennes et les forces expéditionnaires de la Ligue arabe.
Contrairement à ce que représente le narratif israélien, les Britanniques n’aidèrent pas les Palestiniens et n’encouragèrent pas l’invasion arabe. Au contraire, l’effondrement des Palestiniens se produisit alors que les Britanniques étaient encore les maîtres en Palestine, disposant de suffisamment de forces aériennes et terrestres dans le pays pour stopper la Haganah : mais déterminés à achever leur retrait en respectant le calendrier prévu, ils répugnaient à intervenir. La Grande-Bretagne avait pour objet principal de préparer le terrain pour qu’Abdallah, le roi de Transjordanie, s’empare des régions arabes du pays après la fin du mandat. L’ambition du roi violait la résolution de l’ONU prévoyant la création d’un État palestinien, et ses aspirations étaient impopulaires, mais il n’y avait aucune alternative réaliste. Ce complot britanno-transjordanien contre les Palestiniens produisit une autre intrigue visant à modifier le plan de partage au détriment d’Israël. La Grande-Bretagne s’efforça de retrancher le Néguev – région désertique du sud de la Palestine – de l’État juif, afin de préserver la continuité territoriale du monde arabe, tout en accordant à l’Arabie saoudite un débouché sur la Méditerranée. Ainsi, le roi de Transjordanie aurait pu faire étalage d’une réalisation spectaculaire au profit de la cause arabe générale, en justifiant son occupation de la Palestine arabe et en s’abstenant de s’engager dans une guerre contre les Juifs. Bien évidemment, c’était Israël qui devait payer le prix de ce plan. Les manœuvres britanniques cependant n’aboutirent point. Fin avril 1948, il semblait que, sans intervention extérieure, les Juifs pourraient s’emparer du pays tout entier. Ce qui impliquait la fin de la Palestine arabe et un autre afflux de réfugiés dans les pays voisins. Ainsi, la débâcle des Palestiniens dans la guerre entre civils précipita l’invasion et la guerre israélo-arabe. Rivalités et animosité au sein de la Ligue arabe rendirent difficile la création d’une coalition militaire, mais sous la pression de l’opinion publique embrasée par les nouvelles de Palestine, les Arabes décidèrent à contrecœur d’envahir le pays. Le narratif israélien affirme que l’invasion avait été planifiée dès la résolution de partage et qu’elle avait pour objectif de « jeter les Juifs à la mer ». Cependant, les forces expéditionnaires arabes étaient incapables de s’emparer du pays. Il s’agissait, par ce slogan de propagande, de mobiliser un soutien intérieur à de piètres politiciens qui avaient pris une décision cruciale dont ils redoutaient les conséquences. Entraînés dans la guerre par l’effondrement des Palestiniens et de l’Armée de la Ligue arabe, les gouvernements arabes voulaient avant tout empêcher la Haganah d’occuper toute la Palestine, épargner aux Palestiniens un effondrement total et éviter à leurs pays l’afflux d’autres réfugiés. Le Yishouv pour sa part interprétait l’agression arabe de façon radicalement différente. Compte tenu de l’opposition violente des Arabes palestiniens à l’entreprise sioniste depuis le début des années 1920, et au vu du soutien apporté à leur lutte par les États arabes depuis 1936, le Yishouv percevait véritablement que la perspective d’une invasion arabe menaçait son existence même. Ne connaissant pas vraiment l’efficacité militaire des armées arabes, les Juifs prirent la propagande arabe au pied de la lettre, se préparant au pire et réagissant en conséquence.
Guerre d’indépendance ou épuration ethnique ? Comme les archives des pays arabes ne sont pas accessibles, même à leurs propres chercheurs, on ne peut guère parler d’historiographie arabe, mais plutôt du narratif portant sur cette guerre. Il décrit les Palestiniens comme un mouvement de libération national luttant contre un colonialisme étranger (sioniste) soutenu par les Britanniques puis la puissance militaire impérialiste américaine, s’appropriant une terre appartenant à d’autres. Ce narratif vise principalement à étayer les griefs palestiniens contre le sionisme et à souligner le caractère arabe du pays. Les Palestiniens commencèrent à développer leur argumentaire au début des années 1920, puis dans leurs appels au gouvernement britannique et dans leurs délibérations avec les commissions chargées de la Palestine dans les années 1930 et 1940. À cette époque, le colonialisme était légitime et fort répandu, leurs griefs n’attiraient guère l’attention. Dans les années 1950, les Palestiniens qui rédigeaient des mémoires sur la guerre ne condamnaient pas les Juifs. Ils accusaient avant tout leurs propres dirigeants et les États arabes de négligence, les rendant responsables de la catastrophe qui avait frappé leur peuple. Nimr al-Hawari, le commandant de la milice palestinienne al-Najada, qui fut par la suite juriste et juge de district israélien à Nazareth, tenait le grand Mufti de Jérusalem et le Haut comité arabe pour responsables. Nimr al-Khatib, chef des Frères musulmans à Haïfa, reprochait aux Arabes leur impréparation, tandis que le Mufti et ses adjoints, comme Emil Ghory, blâmaient les gouvernements arabes. Depuis plusieurs années, les textes arabes sur la Nakba et ses conséquences sont récriminateurs et polémiques plutôt que scientifiques ou analytiques. Obsédés par la question de l’injustice et du préjudice, les auteurs palestiniens ne tentent pas de découvrir ce qui s’est réellement passé. Ils s’attachent plutôt aux revendications et confèrent une signification indue à des documents juridiques ou déclaratifs comme les résolutions de l’ONU , sur lesquelles les Palestiniens fondent leur revendication du « droit au retour ». Cependant ils évitent toute mention de l’opposition acharnée des Arabes à ces résolutions : ce ne fut qu’après leurs défaites militaires qu’ils firent de ces textes dont ils avaient entravé l’adoption, la pierre angulaire de leur cause. Quant aux Palestiniens, ce n’est qu’en 1988 que l’OLP a soutenu avec hésitation la résolution 181 en assortissant son geste de plusieurs conditions. Réticents à admettre que le minuscule Yishouv avait vaincu leurs forces expéditionnaires, les Arabes tentèrent d’abord d’atténuer leur humiliation en désignant des complices, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le roi Abdallah de Transjordanie. Mais depuis les années 1980, un narratif palestinien révisé nie que le Yishouv ait été si minuscule, et souligne son « écrasante » supériorité, aussi bien sur les Palestiniens que sur les armées arabes. Il est vrai qu’il n’y a pas de miracles dans la guerre. Le plus fort l’emporte, et la guerre de 1948 ne fit pas exception. Ce fut cependant une guerre relativement longue, au cours de laquelle le rapport des forces changea à plusieurs reprises. Pendant la période critique, entre l’invasion et la première trêve, les armées arabes étaient supérieures à Tsahal en armes et en équipement, et leurs troupes étaient fraîches, tandis que la Haganah était épuisée par six mois de combat contre les Palestiniens et l’Armée de libération arabe. Le rapport des forces changea pendant la première trêve de juin-juillet. Ben Gourion admit la supériorité de l’armée d’Israël dès la fin de la guerre et sur ce point, les auteurs palestiniens et post-sionistes n’ont rien découvert. À l’exception de l’historiographie officielle jordanienne, l’historiographie arabe et palestinienne de la guerre , ainsi que celle de nombreux post-sionistes en Israël et à l’étranger, ignorent obstinément le fait qu’à deux reprises, Abdallah a littéralement sauvé les Palestiniens d’un total désastre : la première fois en envahissant la partie arabe de la Palestine ; la seconde en renonçant à la guerre et en négociant avec Israël, empêchant ainsi l’occupation de la Rive occidentale du Jourdain par Tsahal. Depuis les années 1980, prenant exemple sur Edward Saïd, le narratif palestinien privilégie deux thèmes principaux : le problème des réfugiés et le monde arabe disparu d’avant 1948. La critique des débuts, dirigée contre les dirigeants palestiniens et les États arabes, est tombée dans l’oubli. Les Palestiniens décrivent Israël comme étant conçu et né dans le péché, et le sionisme comme une idéologie de la force visant, dès le début, à conquérir et à expulser les Palestiniens désarmés. Israël est accusé de « purification ethnique ».
Dans leurs écrits sur le problème des réfugiés, les Palestiniens ignorent l’essentiel de la documentation sur le sujet. D’une façon générale, ils ferment les yeux sur le contexte historique, comme l’impact du combat et des conditions socio-économiques sur l’exode. Ils préfèrent recueillir des témoignages et publier des mémoires sur la Nakba et sur la société palestinienne d’avant la guerre, qu’ils décrivent comme un âge d’or palestinien. Ce phénomène peut être considéré comme une formulation particulière de la grande vague de souvenirs et de nostalgie qui traverse le monde. Il ne s’agit cependant pas d’une fuite vers le passé, mais d’une fuite du passé, d’une évasion : il n’y eut pas le moindre « âge d’or » ; ce fut une époque de misère, de fer, de sang et de feu. Rashid Khalidi soutient que les origines de la Nakba doivent être recherchées précisément à cette époque. La Nakba est imputable à la faiblesse structurelle des institutions politiques et aux contraintes dans leurs actions ; au morcellement et au sectarisme de l’élite palestinienne ; à l’échec de la « politique des notables » ; aux insuffisances personnelles des dirigeants et au fiasco de la révolte palestinienne des années 1930. Tout cela, soutient-il – jusqu’ici à juste titre – détermina d’avance l’issue de la guerre de 1948. La question qui se pose n’est donc pas : pourquoi les Palestiniens ont-ils perdu la guerre, mais pourquoi l’ont-ils déclenchée ? L’État palestinien que l’ONU avait résolu de créer en novembre 1947 n’a pas vu le jour parce qu’il a été étouffé dans l’œuf, écrit Khalidi. Les Palestiniens ont en fait tué l’État qui leur était proposé en rejetant le Partage, bien que Khalidi s’abstienne de mentionner cet argument comme la raison principale. Il soutient également que les Palestiniens n’avaient pas la moindre chance face à l’écrasante supériorité militaire d’Israël. Il blâme en outre les États arabes pour leur collusion avec la Grande-Bretagne et accuse le monde d’avoir été indifférent au sort des Palestiniens. The Iron Cage de Khalidi est un ouvrage de justification. Il tente de disculper les Palestiniens qui n’ont pas su atteindre leurs objectifs nationaux au XXe siècle et qui, au siècle suivant réitèrent inlassablement leurs ratés. À première vue, il ne ménage guère les inconséquences des Palestiniens et commente même nombre de leurs attitudes les moins avisées ; il trouve cependant toujours quelqu’un d’autre à accuser, quelqu’un qui est en fin de compte responsable d’eux.
En Occident, les tenants du narratif palestinien affirment que, puisqu’il représente « l’autre », il mérite un statut égal au narratif israélien. Dans les années 1990, Ilan Pappe apparut comme un historien relativiste réclamant l’égalité des droits pour le narratif palestinien. Quelques années plus tard, semble-t-il après une épiphanie, il renaquit positiviste, découvrant l’existence de la « vérité objective et définitive ». Cette vérité objective est la nouvelle affirmation palestinienne selon laquelle il n’y eut pas de guerre en Palestine en 1948, mais une purification ethnique préméditée, lancée et planifiée par les Juifs . Pappe qualifie quiconque n’accepte pas cette « vérité définitive » de « négationniste de la Nakba ». Qui plus est, il soutient que le récit de la guerre « devrait être reconstitué sur la base des témoignages des victimes et non à partir des documents de leurs persécuteurs ». Une telle méthodologie lui permet semble-t-il d’affirmer que « seule l’armée égyptienne envahit l’État juif en 1948. » Ainsi, d’un trait de plume, il modifie la résolution de partage, excluant de l’État juif la vallée du Jourdain, la vallée de Bashan et la plaine du Sharon, régions qui furent envahies et attaquées par les armées syriennes et irakiennes. La façon dont Juifs et Palestiniens perçoivent les événements de 1948 n’a jamais été plus opposée qu’aujourd’hui. S’il était possible de discerner dans les premiers écrits sur la guerre quelques éléments communs, voire des points sur lesquels Israéliens et Arabes tombaient d’accord, il est difficile actuellement de concilier l’étude des multiples aspects de la guerre avec le nouveau narratif palestinien sur une purification ethnique planifiée qui aurait commencé par le Journal de Herzl en juin 1895 et se poursuivrait jusqu’à nos jours dans les localités israéliennes des « territoires ». Présenter une description rigoureuse de la guerre de 1948, en mettant l’accent sur la fuite en masse des Palestiniens, ses causes, son ampleur et la façon dont elle a été transformée en un problème de réfugié quasi-permanent reste un objectif historique nécessaire.
Yoav Gelber, Professeur à l’Université de Haïfa
Palestine 1948, guerre d’indépendance ou catastrophe ?, Les provinciales, 2013, traduction Claire Darmon.
